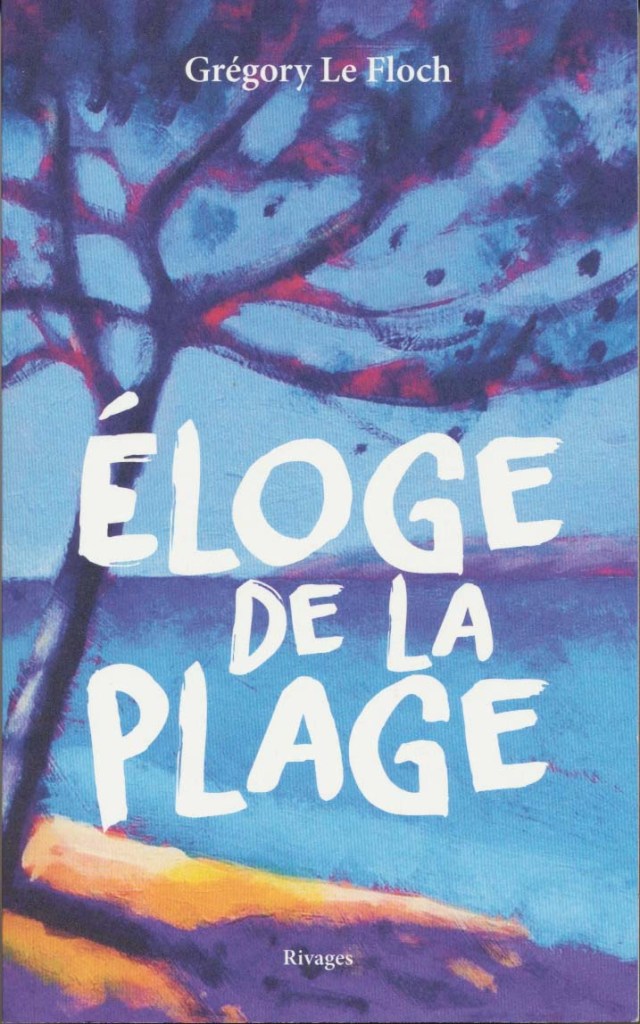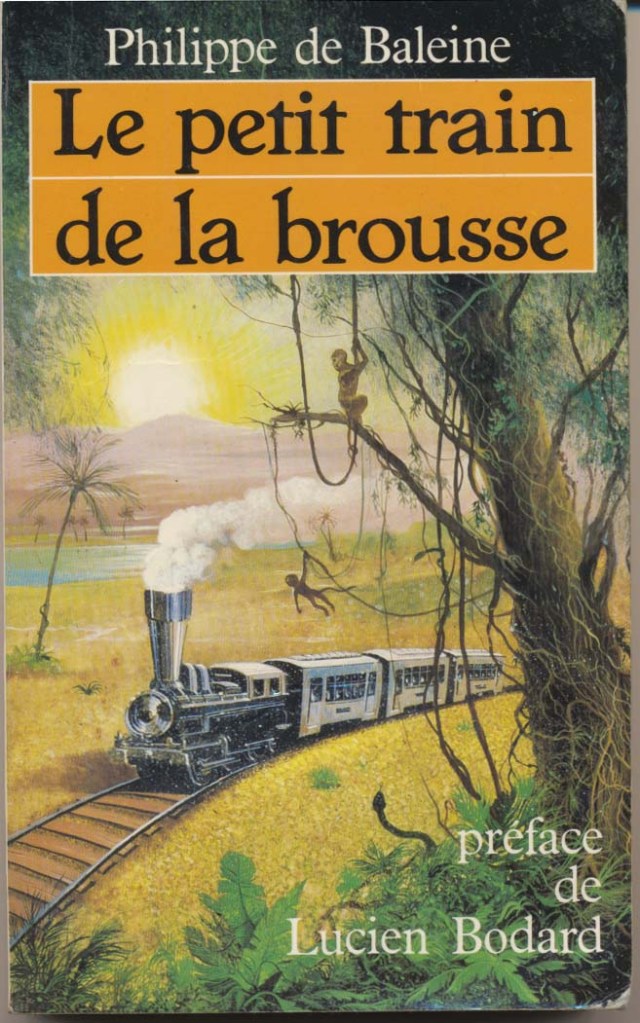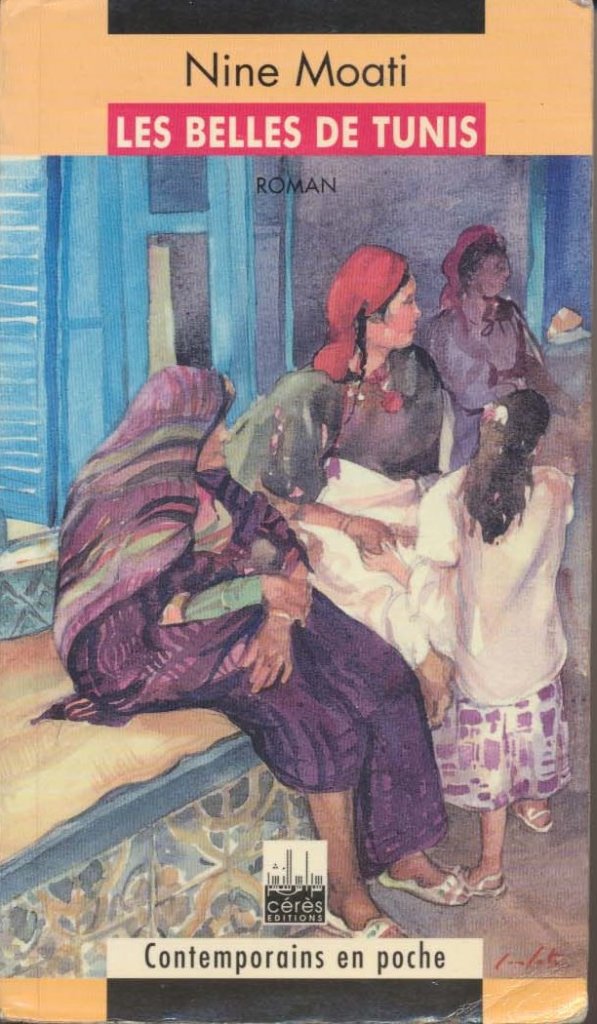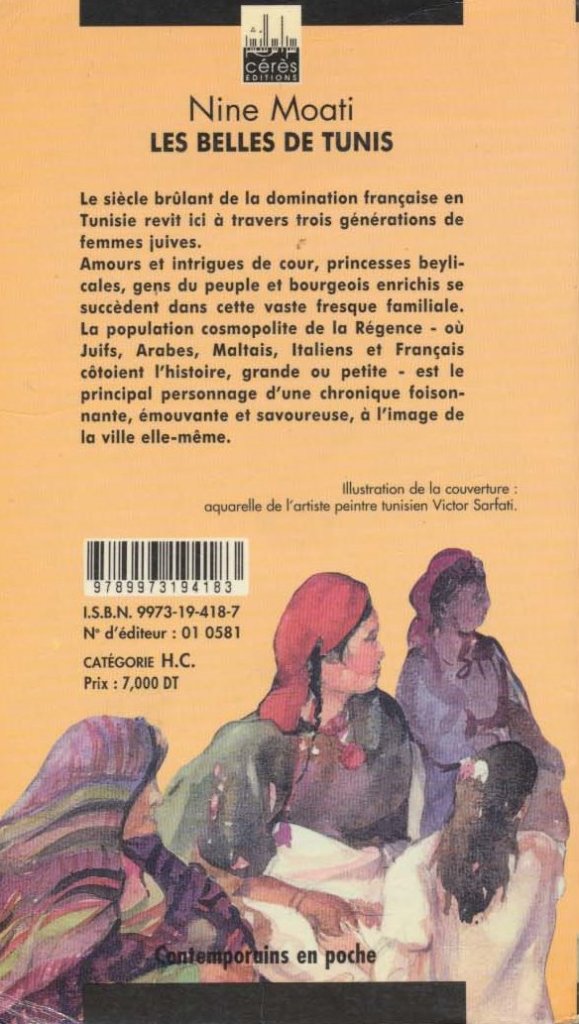Je venais juste d’avoir dix-sept ans. J’arrivais en vélo, depuis Schramberg en Forêt-Noire, après avoir traversé la Forêt-Noire, les Vosges via le Col de la Steige, la Lorraine en passant par Colombey les Deux Églises. En fait c’était un pari avec mes camardes cavaliers du club d’équitation de Schramberg du Beschenhof à Schramberg-Sulgen, – que j’arriverais à faire le trajet « Schramberg- Paris » en trois jours en vélo. La nuit tombant, longeant la Seine, Quai de la Tournelle, Quai de Montebello je découvris la silhouette de la Cathédrale Notre-Dames de Paris. J’en fu ébloui, et ébloui je continuais à forcer les pédales, j’avais encore les Champs-Élysées devant moi, avant d’enfin arriver à la Place de l’Etoile. En fait, je ne me rappelle plus très bien si les frères et sœur Laetitia & Bruno M., m’avaient cherché en voiture avec leur père, à la Place de l’étoile ou à la Porte Maillot, mais je pense que ce fut la Porte Maillot. Mais je me rappelle encore très bien les pavés des Champs-Élysées, j’étais crevé il faisait nuit, et comparé à la Haupstrasse de Schramberg, il y avait une circulation assez dense.
Laetitia et Bruno, que je les ’avais connus au camping de Mus, dans le Gard pas loin de Vergèze. C’est au camping du Mus, ce camping qui longeait la voie ferrée Nîmes – Montpellier, qu’on avait passé l’été 1980 en famille avec la tante et l’oncle alsacien, – mon grand-père Jean Migliori était malade, mourant – et nous passions les journées soit à l’hôpital à Nîmes, soit chez la grand-mère à Aubord, – soit parfois à la plage au Grau – du – Roi ou à La Grande Motte, ou simplement à la petite piscine de Calvisson. C’était en 1980 et il y avait encore des trains de marchandise sur la ligne de Chemins de Fer Nîmes- Sommières -Le Vigan. On pouvait voir passer le train du soir vers Le Vigan, en fin d’après-midi depuis la piscine de Calvisson. D’une part ce fut un été triste, car je perdais mon grand-père, – mais le chagrin n’était pas trop douloureux, grâce aux amitiés de vacances de camping comme Bruno et Laetitia. Donc en été 1981 je leurs rendis visite en faisant le trajet Forêt-Noire – Paris en vélo.
Voyant « Notre Dame » en flammes, ce soir du lundi 15 avril 2019 sur mon écran notebook, je me suis souvenu comment j’ai aperçu dans les derniers rayons de soleil d’un soir d’été en 1981 depuis mon vélo la vielle « Dame ». Mes visites de « Notre Dame », la première tout de suite après avoir débarqué à vélo à Paris, où j’avais entre autres visité une partie de la charpente, cette forêt de poutres. Je suis revenu plusieurs fois depuis rendre visite à la vielle dame, la dernière fois je pense ce fut durant un congrès en 2002[1]. En fait je ne logeais qu’à quelques pas de l’Île de la Cité , le congrès se tenait à la Sorbonne. C’était d’ailleurs aussi la dernière fois que je mis les pieds à Paris intra-muros. Depuis j’ai vu assez souvent Notre Dame et aussi la tour Eiffel depuis l’avion traversant le ciel de Paris, les avions reliant Francfort à Lisbonne survolent assez souvent Paris. Et naturellement beaucoup de changements d’avion à CDG ou à Orly, sans mettre les pieds en dehors de l’aéroport. Le contact avec Bruno & Laetitia s’endormit pendent mon bac, le service militaire, -mes stages d’application d’officier de réserve à la Bundeswehr etc. Les flammes de Notre Dame ont fait ressurgir les souvenirs de ma première rencontre avec Notre Dame en 1981, de l’été passé chez Laetitia & Bruno – et ceci après presque 38 longues années.
Voyant la toiture de Notre Dame dévorée par les flammes j’avais l’impression que le cœur de la France éternelle saignait. Notre Dame de Paris n’est certainement pas la seule église avec laquelle j’ai disons un lien affectif spécial. La Cathédrale de Strasbourg certes, – pour diverses raisons familiales & personnelles, mais aussi historiques comme par exemple le serment de Koufra « « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg » ou pour ainsi dire où souvenirs personnels et histoires convergent, – pour ma grand-mère Germaine Migliori, qui décéda en 2011, c’était certainement son église, sa cathédrale. Dans mes souvenirs d’enfance[2] – la cathédrale de Strasbourg fut certainement la plus grande, la plus impressionnante et certainement la plus belle des Cathédrales.
Ou la petit église St.Nickolaus à Buchenberg (Königsfeld), église presque millénaire, certainement une des plus anciennes églises de Forêt – Noire, qui est tellement inconnue, dont on ne trouve même pas d’article Wikipédia, et je parle ici de wikipedia.de. Perdue au fond de la Forêt – Noire elle attend d’être découverte par le pèlerin à la recherche d’églises romanes dans le Sud de l’Allemagne. Ou par exemple les vitraux de la Cathédrale Saint-Paul d’Abidjan m’ont laissé un souvenir inoubliable. Ou le silence du Prieuré de Serrabone sur les contreforts du Canigou,- mais apparemment je dirais que dans ma géographie imaginaire- Notre Dame de Paris et l’Ile de la Cité est le cœur de la France éternelle – ou le centre de ma géographie imaginaire de la France.
En voyant les blessures et les séquelles que l’incendie de dimension dantesques a laissées derrière soi, je disais à ma fille Viola, que je ne pensai pas voir de mon vivant la Cathédrale de Notre Dame reconstruite, – en tous cas pas la « forêt » de la charpente de la toiture. Dans ce contexte les annonces du gouvernement, de reconstruire la cathédrale en cinq ans, me semble être très ambitieuses, et parfois je me demande si en dehors des travaux de stabilisation et de sécurisation où la vitesse s’impose,- il ne serait peut-être pas nécessaire de prendre plus de temps de réflexion, à réfléchir à ce que l’on veut reconstruire[3]. La reconstruction d’un bâtiment millénaire, où l’histoire, l’imaginaire[4], le temps et même divers architectes on laissé leurs traces[5], nécessite je pense un temps d’analyses, de réflexion. Consolider avant de rebâtir à la hâte, me semble être une meilleure option[6].
Peut-être me suis-je trompé en disant à ma fille que je ne verrai pas de mon vivant Notre Dame de Paris reconstruite. Je ne le sais pas. Je sais par contre, que grâce à la formidable action des pompiers de Paris, le pire a été évité, – « Fluctuat nec mergitur » – battue par les flots de l’histoire elle ne sombre pas !
La Cathédrale de Notre Dame en flammes m’a fait ressurgir le souvenir, de l’été 1981 – une aventure en bicyclette entre Schramberg et Paris, l’Île de la Cité, le quai de Montebello, la charpente dite la « forêt » de Notre Dame. En 1981, c’était déjà un monument très apprécié par les touristes, mais l’affluence n’était en aucun cas comparable aux masses de touristes de nos jours. On pouvait encore, après avoir gravi les 387 marches pour attendre le sommet de la tour sud paisiblement regarder les flots de la Seine s’écoulant sous le petit pont, les bouquinistes sur les quais de la Seine, – c’était un peu le paysage – dont nous parlait notre livre de français au Gymnasium Schramberg. Le livre s’appelait « Salut », et entre 1975 -1985 de milliers de lycéens allemands du Bade-Wurtemberg apprenaient leurs premiers mots de français, dans un paysage imaginaire que ce livre d’apprentissage de français dessinait entre « Boul Mich » et l’Île de la Cité. C’était très loin de l’image du roman de Victor Hugo sur Notre Dame de Paris. Mais ce fut aussi une découverte des paysages de Paris. La plupart de mes collègues bacheliers ont surement découvert « Notre Dame de Paris », comme d’ailleurs moi-même par le film de Jean Delannoy sur le scenario de Jean Autrèche et de Jacques Prévert se basant sur le roman de Victor Hugo avec l’interprétation inoubliable de Gina Lollobrigida dans le rôle d’Esméralda[7]. Plus tard j’ai lu des extraits du livre dans la bibliothèque de mes grands-parents à Aubord. C’était un volume des Œuvres complètes de Victor Hugo du Club français du livre édité par Jean Massin. Peut-être un jour relirai- je le roman de Victor Hugo – sûrement en version poche – car Œuvres complètes de Victor Hugo du Club français du livre édité par Jean Massin dans leurs reliures rouges si caractéristiques semble avoir disparu dans les méandres du temps de l’héritage familial.
Et naturellement je reviendrai sur les lieux de ma jeunesse, pour voir comment progressent les travaux de reconstruction de « Notre-Dame de Paris », et pour me souvenir d’un voyage en vélo de Schramberg à Paris à travers la Forêt – Noire et les Vosges, l’ascension du Col de la Steige. C’était 1981, quelques semaines après l’élection de François Mitterrand, le peuple de gauche fêtait la victoire (on a gagné !!!)[8] – et moi j’étais jeune – et je fêtais surtout ma jeunesse.
Quelques 15 années plus tard je suivais les obsèques de Mitterrand à Notre Dames de Paris à la télé[9], – la voix de Barbara Hendricks, les mots du Cardinal Lustiger, les larmes de Helmut Kohl résonnaient dans Notre Dame et sur nos écrans de téléviseurs et ceci même en Allemagne….[10]
Photo(s) prise(s) par ma fille, Viola Veronika durant une visite de Notre Dame, en aout 2015 (© V.V. Neff 2015, © blog paysages 2019)
Sources & Ouvrages citées :
Filippetti, Aurélie (2003) : Les derniers Jours de la classe ouvrière. (Stock – Le Livre de Poche), ISBN 2-253-10859-6
En plus différentes versions de « Notre-Dame de Paris. 1482 » de Victor Hugo.
Christophe Neff, écrit pendant la semaine sainte 2019, publie le Samedi 20.04.2019
P.S. : C’est certainement un des derniers billets de paysages dans sa formule « Les Blogs Le Monde ». Comme je l’ai déjà décrit dans le précédent billet, le Monde va fermer les blogs abonnés le 5. Juin 2019.
[1] Ce fut la participation au Congrés „Environmental dynamics and history in Mediterranean areas, Paris, Universite de Paris-Sorbonne, 24-26 avril 2002“
[2] Avant de déménager à Aubord dans le Gard, mais Grand-parents habitait à Eckbolsheim près de Strasbourg, – et je passais beaucoup de temps chez eux, voir aussi : « Les cloches de Pâques introuvables sur Wikipedia.fr (24.4.2011) » et « Blognotice 22.01.2013: pensées personnelles franco-allemandes sur le cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée ».
[3] Voir aussi le tweet d’Aurélie Fillipetti « Reconstruire…bien sûr. Mais pourquoi tant de hâte? Pour nous rassurer de quoi? Serions-nous incapables d’accepter une part d’irrémédiable? Même refaite à l’identique NotreDame ne sera jamais la même; cet incendie est inscrite dans son histoire. Prenons le temps de la tristesse. »
[4] Voir aussi par exemple Anne-Marie Thiesse « Avec Hugo, Notre-Dame est devenue la cathédrale de la nation » dans le Monde (MERCREDI 17 AVRIL 2019,p.14) (version électronique ici), ou Raphaëlle Leyris « Une « cathédrale de poésie » devenue source d’inspiration pour la littérature D’innombrables écrivains, à la fois français et étrangers, ont chanté dans leurs écrits les louanges du majestueux édifice, à l’image de Victor Hugo » (MERCREDI 17 AVRIL 2019,p.13) (version électronique ici).
[5] Voir aussi l’article de Laurent Carpentier « Viollet – le – Duc, restaurateur de mythes. L’architecte français réinventa Notre Dame de Paris au XIXe siècle, en se référant à un Moyen Age revisité » dans le Monde, SAMEDI 20 AVRIL 2019, p.24, version électronique voir ici.
[6] Dans se contexte je suggere de lire « Notre-Dame : pour une cathédrale du XXIe siècle », l’editorial du Monde du 18.04.2019 (Éditorial du Vendredi 19 avril 2019,p.30 dans la version imprimée du Monde)
[7] Sur le rôle du cinéma dans l’imaginaire de Notre Dame, voir aussi « Au cinéma, le joyau gothique piégé dans le rôle que lui a écrit Hugo La cathédrale parisienne doit l’essentiel de sa carrière – essentiellement hollywoodienne – au roman de l’écrivain » de Thomas Sotinel dans le Monde du MERCREDI 17 AVRIL 2019, p.13.
[8] Très belle description de l’ambiance festive après la victoire de François Mitterrand en 1981 dans le chapitre« Le Grand Soir » du roman autobiographique « les derniers jours de la classe ouvrière » de Aurélie Filipetti. Au début de paysages j’avais déjà écrit quelques mots sur ce roman dans les billets «I. Un blog sur les paysages : un petit début – ou quelle langue choisir ? », « Blogroll : Aurélie Filippetti », et puis pour la sortie de la traduction allemande du livre ceci « Blognotice 03.12.2014: La traduction allemande de « La fin de la classe ouvrière » d’Aurèlie Filippetti dans les 20 livres à lire du Literaturherbst 2014 du Spiegel-online ».
[9] Sur le rôle de Notre Dame dans l’histoire de France voir par exemple « Une cathédrale dans l’histoire Construit il y a plus de 850 ans, l’édifice a été témoin des grands événements qui ont marqué le pays » le récit de Jérôme Gautheret dans le Monde (MERCREDI 17 AVRIL 2019, p.12)(version électronique ici)
[10] Document Ina sur les obsèques de François Mitterrand à la Cathédrale Notre-Dame de Paris. A voir ici !